-
Ci-dessus, photocall avec mon amie Pascale Breton du blog Beauty Clap.
Après avoir longtemps eu lieu à la Mairie de Paris puis au théâtre de la Madeleine l’an passé, c’est à l’Institut du Monde Arabe que s’est déroulée la cérémonie de remise des prix Lumières de la presse internationale 2018. Une cérémonie qui, chaque année, prend davantage d’ampleur et gagne en professionnalisme. Ces prix annuels ont ainsi été créés en 1995 à l’initiative de Daniel Toscan du Plantier et du journaliste américain Edward Behr. Une centaine de films sortis en salles en 2017 concouraient pour les nominations aux Lumières de la presse internationale et 44 furent soumis au vote final de 80 académiciens représentant plus de trente pays. La soirée était animée par Laurie Cholewa et Pierre Zeni.

La cérémonie s’est ouverte avec Au feu rouge, film de Mehdi Idir et Grand Corps Malade. Un clip qui a donné le ton de la soirée, sous le signe de la musique et de l’émotion. La belle voix grave de Grand Corps Malade qui vous étreint le cœur et l’âme a projeté face à face deux réalités. Celle des spectateurs de la soirée, confortablement installés dans leurs fauteuils en cuir de l’Institut du Monde Arabe ou celle du chauffeur au feu rouge. Et celle, de l’autre côté de la vitre, qui charrie tant de douleurs et de drames. Percutant et bouleversant.
D’autres musiques ont ponctué la soirée. Celle de 120 battements par minute (d’ailleurs récompensée lors de la soirée). Celle de Borsalino lors de l’émouvant hommage à l’immense Jean-Paul Belmondo. Réminiscences d’enfance lors de laquelle j’ai tant de fois vu et revu ce film comme tant d’autres de l’acteur. L’Académie des Lumières, composée d’une centaine de correspondants représentant plus de vingt pays, a rendu en effet un hommage spécial à l’actrice Monica Bellucci et à l’acteur Jean-Paul Belmondo pour leur contribution au rayonnement mondial du cinéma français. A cette occasion, je vous propose ainsi, en bas de cette page, trois critiques de films avec Jean-Paul Belmondo, deux films que j’affectionne tout particulièrement : Itinéraire d’un enfant gâté de Claude Lelouch et La Sirène du Mississsippi de François Truffaut. Mais aussi bien sûr la critique de Borsalino de Jacques Deray. Ci-dessous, mes vidéos de ces émouvants hommages et notamment de celui à Jean-Paul Belmondo qui a donné lieu à une longue standing ovation.
12O battements par minute – dont vous pouvez retrouver ma critique en bas de cet article- s’est imposé dans les six catégories où il était nommé, voilà un bon présage pour le film de Robin Campillo pour la cérémonie des César qui aura lieu le 3 mars. Un film qui rend magnifiquement hommage à ces combattants, à leur ténacité. Lorsque, finalement, le désir de vie l’emporte, avec ces battements musicaux et cardiaques, qui s’enlacent et se confondent dans un tourbillon sonore et de lumières stroboscopiques, qui exaltent la force de l’instant, et nous accompagnent bien après le générique de film, Campillo nous donne envie d’étreindre furieusement le moment présent. Un grand film.
-meilleur film produit par Hugues Charbonneau et Marie-Ange Luciani (Les Films de Pierre)
– meilleur réalisateur, pour Robin Campillo
-meilleur acteur, pour l’Argentin Nahuel Pérez Biscayart
– révélation masculine pour Arnaud Valois
– meilleur scénario pour Robin Campillo et Philippe Mangeot
– meilleure musique composée par Arnaud Rebotini
Barbara, de Mathieu Amalric, a reçu deux prix :
– pour Jeanne Balibar comme meilleure actrice et pour l’image de Christophe Beaucarne. Des prix là aussi mérités pour ce film qui ne cherche pas forcément à séduire et encore moins à nous prendre par la main avec des facilités scénaristiques. Il se mérite, se dérobe et se cherche. Et capture pourtant notre attention et notre émotion comme le ferait une chanson de Barbara, avec intensité. Celle que met l’étonnante Jeanne Balibar pour l’incarner au point de se confondre avec celle dont elle joue le rôle comme son personnage se confond avec la chanteuse qu’elle interprète. C’est le sentiment d’une œuvre poétique, abrupte, confuse, audacieuse, inclassable qui domine. Tour à tour agaçante et séduisante. Quatre femmes en une. Balibar la femme que la caméra caresse. Balibar l’actrice. L’actrice qu’elle incarne dans le film, Brigitte. Barbara qu’incarne l’actrice qu’elle incarne dans le film réalisé par le réalisateur Amalric,…lui-même réalisateur dans son film. De ce dédale inénarrable, on ressort avec le souvenir d’une voix, celle de Barbara/Balibar, envoûtante, et d’une femme, de femmes, fantaisistes, captivantes et fuyantes. Et d’une actrice impressionnante.« Vous faites un film sur Barbara ou un film sur vous. » demande ainsi Brigitte interprétant Barbara au réalisateur Amalric dans le film. « -C’est pareil » lui répond le réalisateur s’immisçant dans la scène du film. Sans doute Amalric réalisateur pourrait-il nous faire la même réponse tant et surtout ces images parcellaires dessinent une déclaration d’amour du réalisateur dans le film à son actrice dans le film, à la chanteuse Barbara, et peut-être du réalisateur Amalric à l’actrice Balibar.
Laetitia Dosch a été distinguée comme révélation féminine dans Jeune femme de Léonor Serraille, le film avait déjà été récompensé de la Caméra d’or lors du dernier Festival de Cannes et du prix d’Ornano lors du dernier Festival du Cinéma Américain de Deauville.
Le prix du documentaire est allé à Visages Villages, d’Agnès Varda et JR. Seule Agnès Varda était présente avec son enthousiasme et son espièglerie légendaires tandis que JR était en campagne aux Etats-Unis pour les Oscars. Retrouvez critique consacrée au formidable Visages, villages en bas de cet article. Ode au pouvoir de l’imagination, plein de poésie, délicatesse et bienveillance à voir absolument et auquel nous souhaitons le meilleur pour les César et les Oscars.
.
Le grand méchant Renard et autres contes, de Benjamin Renner et Patrick Imbert, a reçu le prix de l’animation.
Une famille syrienne, du réalisateur belge Philippe Van Leeuw, a remporté le prix réservé aux films des pays francophones.
En attendant les hirondelles, de Karim Moussaoui, a été primé dans la catégorie du premier long métrage
Les lauréats ont reçu le nouveau trophée en bronze – “une bande flamme ajourée dont l’âme, le foyer, la mèche est la tour Eiffel“ – créé spécialement par la Monnaie de Paris pour les Lumières.
Palmarès
Film
120 battements par minuteRéalisateur
Robin Campillo, pour 120 battements par minuteActrice
Jeanne Balibar, pour BarbaraActeur
Nahuel Pérez Biscayart, pour 120 battements par minuteImage
Christophe Beaucarne, pour BarbaraScénario
Robin Campillo, Philippe Mangeot, pour 120 battements par minuteMusique
Arnaud Rebotini, pour 120 battements par minuteRévélation féminine
Laetitia Dosch, pour Jeune femme
Révélation masculine
Arnaud Valois, pour 120 battements par minutePays francophones
Une famille syrienne, de Philippe Van Leeuw (Belgique)Premier film
En attendant les hirondelles, de Karim MoussaouiDocumentaire
Visages Villages, d’Agnès Varda et JR
Film d’animation
Le grand méchant Renard et autres contes, de Benjamin Renner et Patrick Imbert
CRITIQUE de 120 BATTEMENTS PAR MINUTE de Robin Campillo

Cette critique est extraite de mon compte rendu du Festival de Cannes 2017 à retrouver ici. « 120 battements par minute » a également obtenu le prix du public du Festival du Film de Cabourg 2017 dont vous pouvez retrouver mon bilan, là.
C’est le film qui avait bouleversé les festivaliers au début de la 70ème édition du Festival de Cannes et qui méritait amplement son Grand Prix. C’est d’ailleurs avec beaucoup d’émotion que Pedro Almodovar l’avait évoqué lors de la conférence de presse du jury du festival. On sentait d’ailleurs poindre un regret lorsqu’il a déclaré : « J’ai adoré 120 battements par minute. Je ne peux pas être plus touché par un film. C’est un jury démocratique. Et je suis 1/9ème seulement. » Il avait également déclaré : « Campillo raconte l’histoire de héros qui ont sauvé de nombreuses vies. Nous avons pris conscience de cela. »

Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants d’Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l’indifférence générale. Nouveau venu dans le groupe, Nathan (Arnaud Valois) va être bouleversé par la radicalité de Sean (Nahuel Perez Biscayart) qui consume ses dernières forces dans l’action. Sean est un des premiers militants d’ Act Up. Atteint du VIH, il est membre de la commission prisons. Au film politique va s’ajouter ensuite le récit de son histoire avec Nathan, nouveau militant, séronégatif.
Le film s’attache en effet à nous raconter à la fois la grande Histoire et celle de ces deux personnages. Celle d’Act Up se heurtant aux groupes pharmaceutiques, essayant d’alerter l’opinion publique et le gouvernement insensible à sa cause. Celle de l’histoire d’amour entre Sean et Nathan. Deux manières de combattre la mort. La première est racontée avec une précision documentaire. La seconde est esquissée comme un tableau avec de judicieuses ellipses. L’une domine tout le début du film avant que la seconde ne prenne une place grandissante, le film se focalisant de plus en plus sur l’intime même si le combat est toujours présent, en arrière-plan.
La durée du film (2H10) devient alors un véritable atout nous permettant de nous immerger pleinement dans leur action et de faire exister chaque personnage, de nous les rendre attachants, de nous permettre d’appréhender la violence apparente de leurs actions qui deviennent alors simplement à nos yeux des appels au secours, des cris de colère, si compréhensibles. Parce qu’il n’y a pas d’autre solution face à l’indifférence et l’inertie. Parce que le temps court et leur manque. La caméra s’attache et s’attarde à filmer les visages et les corps, vivants, amoureux, mais aussi les particules qui les détruisent inéluctablement. Deux réalités qui s’opposent. Une course contre la montre. Contre la mort.
Nahuel Pérez Biscayart, Arnaud Valois et Antoine Reinartz sont impressionnants de force, d’intensité, de justesse, de combattivité. Ils rendent leurs personnages furieusement vivants et Adèle Haenel impose sa colère avec force, totalement imprégnée de son rôle.
Campillo démontre ici une nouvelle fois son talent de scénariste (il fut notamment celui d’ « Entre les murs », palme d’or 2008 mais aussi notamment des autres films de Laurent Cantet), dosant brillamment l’intime et le collectif, l’histoire d’amour et le combat politique et parvenant à faire de chacun des débats, parfois virulents, des moments passionnants, témoignant toujours de ce sentiment d’urgence. Certains ont reproché au film d’être trop long ou bavard mais aucun de ces échanges n’est vain ou gratuit. Ils sont toujours vifs et incisifs, enragés de l’urgence dictée par la maladie et la mort qui rôde. Ne pas s’arrêter, ne pas se taire pour ne pas mourir.
La dernière partie du film, poignante, ne tombe pourtant jamais dans le pathos ni dans la facilité. Campillo raconte avec minutie et pudeur les derniers sursauts de vie, puis la mort et le deuil, leur triviale absurdité. « Mince » réagit une mère à la mort de son enfant. Et c’est plus bouleversant que si elle s’était écroulée, éplorée.
En immortalisant ces combats personnels et ce combat collectif, Campillo a réalisé un film universel, transpirant la fougue et la vie dont chaque dialogue, chaque seconde, chaque plan palpitent d’une urgence absolue. A l’image de la réalisation, effrénée, nerveuse, d’une énergie folle qui ne nous laisse pas le temps de respirer. Avec sa musique exaltant la vie. Ses images fortes aussi comme ces corps allongés sur le sol de Paris symbolisant les défunts, des corps que la caméra surplombe, tourbillonnant autour comme si elle filmait un ballet funèbre. Sa poésie aussi. Un film jalonné de moments de grâce et d’images fortes qui nous laissent une trace indélébile. Lorsque la Seine devient rouge. Lorsque Sean évoque le ciel et la vie, plus prégnante avec la maladie, et que Paris défile, insolemment belle et mélancolique, derrière la vitre, irradiée de soleil.
Un film qui rend magnifiquement hommage à ces combattants, à leur ténacité. Lorsque, finalement, le désir de vie l’emporte, avec ces battements musicaux et cardiaques, qui s’enlacent et se confondent dans un tourbillon sonore et de lumières stroboscopiques, qui exaltent la force de l’instant, et nous accompagnent bien après le générique de film, Campillo nous donne envie d’étreindre furieusement le moment présent. Un grand film.
CRITIQUE de VISAGES, VILLAGES d’Agnès Varda et JR

Que de poésie dans ce film, révélateur de la profondeur, la noblesse, la beauté et la vérité des êtres ! Présenté hors-compétition du dernier Festival de Cannes où il a reçu le prix L’œil d’or du meilleur documentaire, il est coréalisé par Agnès Varda et JR.
Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et questionnement sur les images en général et plus précisément sur les lieux et les dispositifs pour les montrer, les partager, les exposer. Agnès a choisi le cinéma. JR a choisi de créer des galeries de photographies en plein air. Quand Agnès et JR se sont rencontrés en 2015, ils ont aussitôt eu envie de travailler ensemble, tourner un film en France, loin des villes, en voyage avec le camion photographique (et magique) de JR. Hasard des rencontres ou projets préparés, ils sont allés vers les autres, les ont écoutés, photographiés et parfois affichés. Le film raconte aussi l’histoire de leur amitié qui a grandi au cours du tournage, entre surprises et taquineries, en se riant des différences.
Dès le générique, le spectateur est saisi par la délicatesse et la poésie. Poésie ludique des images. Et des mots, aussi : « tu sais bien que j’ai mal aux escaliers » dit Agnès Varda lorsqu’elle peine à rejoindre JR, « Les poissons sont contents, maintenant ils mènent la vie de château» à propos de photos de poissons que l’équipe de JR a collées sur un château d’eau.
« Le hasard a toujours été le meilleur de mes assistants », a ainsi déclaré Agnès Varda et en effet, de chacune de ces rencontres surgissent des instants magiques, de profonde humanité. Sur chacun des clichés, dans chacun de leurs échanges avec ces « visages » affleurent les regrets et la noblesse de leurs détenteurs.
En parallèle de ces explorations des visages et des villages, se développe l’amitié entre ces deux humanistes qui tous deux ont à cœur de montrer la grandeur d’âme de ceux que certains appellent avec condescendance les petites gens (terme qui m’horripile), de la révéler (au sens photographique et pas seulement).
En les immortalisant, en reflétant la vérité des visages que ce soit celui de la dernière habitante de sa rue, dans un coron du Nord voué à la destruction en collant sa photo sur sa maison, à ces employés d’un site chimique, ils en révèlent la beauté simple et fulgurante. Et nous bouleversent. Comme cet homme à la veille de sa retraite qui leur dit avoir « l’impression d’arriver au bout d’une falaise et que ce soir je vais sauter dans le vide ». Et dans cette phrase et dans son regard un avenir effrayant et vertigineux semble passer.
Le photographe de 33 ans et la réalisatrice de « 88 printemps » forment un duo singulier, attachant, complice et attendrissant. Le grand trentenaire aux lunettes noires (qu’Agnès Varda s’évertuera pendant tout le film à lui faire enlever) et la petite octogénaire au casque gris et roux. Deux silhouettes de dessin animé. Les mettre l’un avec l’autre est déjà un moment de cinéma. Tous deux se dévoilent aussi au fil des minutes et des kilomètres de ce road movie inclassable. Et ces visages dont les portraits se dessinent sont aussi, bien sûr, les leur. Ce voyage est aussi leur parcours initiatique. Celui d’un JR gentiment taquin, empathique, et d’une Agnès Varda tout aussi à l’écoute des autres, tantôt malicieuse et légère (impayable notamment quand elle chante avec la radio) tantôt grave et nous serrant le cœur lorsqu’elle dit « la mort j’ai envie d’y être parce que ce sera fini ».
Ce récit plein de vie et fantaisie est aussi jalonné par l’évocation tout en pudeur de ceux qui ne sont plus, du temps qui efface tout (parce que photographier les visages c’est faire en sorte qu’ils « ne tombent pas dans les trous de la mémoire ») comme la mer qui engloutit ce portrait de cet ami d’Agnès Varda qui avait pourtant été soigneusement choisi pour être collé sur un bunker en bord de mer. Et la nostalgie et la mélancolie gagnent peu à peu du terrain jusqu’à la fin. Jusqu’à cette « rencontre » avec le « redoutable » Jean-Luc Godard qui donne lieu à un grand moment de cinéma poignant et terriblement cruel. Jusqu’au lac où la vérité et le regard sont, enfin, à nu. Et le nôtre embué de larmes.
Ajoutez à cela la musique de M. Et vous obtiendrez une ode au « pouvoir de l’imagination », un petit bijou de délicatesse et de bienveillance. Un pied de nez au cynisme. Passionnant. Poétique. Surprenant. Ensorcelant. Emouvant. Rare. A voir absolument.
CRITIQUE de ITINERAIRE D’UN ENFANT GATE de Claude Lelouch
Le Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule (mon compte rendu complet, ici) permet aussi de revoir des classiques du cinéma. Parmi les nombreux classiques au programme (j’aurais aimé tous les revoir mais il a fallu faire des choix) figurait « Itinéraire d’un enfant gâté » de Claude Lelouch, un des plus grands succès du cinéaste datant de 1988, une projection d’autant plus riche en émotions que lui a succédé un échange passionnant avec Richard Anconina. Un film que j’ai choisi de mettre en parallèle avec une avant-première du festival, deux films qui ont en commun d’être des tours de manège, de nous raconter l’histoire d’hommes qui se choisissent une famille et dont les vies sont jalonnées de hasards et coïncidences. Deux films qui sont de magnifiques métaphores du cinéma qui permet de réinventer nos vies.
Sam Lion (Jean-Paul Belmondo) a été élevé dans le milieu du cirque puis a dû faire une reconversion forcée comme chef d’entreprise. Mais la cinquantaine passée, il se lasse de ses responsabilités et de son fils, Jean-Philippe, dont la collaboration ne lui est pas d’un grand secours. Il décide d’employer les grands moyens et de disparaître en Afrique, après avoir simulé un naufrage lors de sa traversé de l’Atlantique en solitaire. Mais son passé va l’y rattraper en la personne d’Albert Duvivier (Richard Anconinia), un de ses anciens employés licencié qu’il retrouve par hasard en Afrique et qui le reconnaît…
« Chaque homme est seul et tous se fichent de tous et nos douleurs sont une île déserte ». La citation d’Albert Cohen qui ouvre le film le place sous le sceau du pessimisme et de la solitude, impression que renforce la chanson de Nicole Croisille qui ouvre le film. « Qui me dira, les mots d’amour qui font si bien, du mal ? Qui me tiendra, quand tu iras décrocher toutes les étoiles ? Qui me voudra, avec le nez rouge, et le cœur en larmes ? Qui m’aimera, quand je n’serai plus que la moitié d’une femme ? » La musique est reprise en chœur tandis qu’un petit garçon seul sur un manège attend désespérément sa mère. Un homme s’occupe de lui, découvre le carton qu’il a autour du cou et qui indique que sa mère l’a abandonné. La musique épique, flamboyante, lyrique, accompagne ensuite les premières années et les numéros de cirque étourdissants qui défilent (sans dialogues juste avec la musique pour faire le lien) jusqu’à l’accident fatidique. Les flashbacks alternent avec les vagues sur lesquelles flotte le navire de Sam Lion, des vagues qui balaient le passé. Les premières minutes sont bouleversantes, captivantes, montées et filmées sur un rythme effréné, celui sur lequel Sam Lion (ainsi appelé parce qu’il a été élevé dans un cirque) va vivre sa vie jusqu’à ce qu’il décide de disparaître.
Rares sont les films qui vous émeuvent ainsi, dès les premiers plans et qui parviennent à maintenir cette note jusqu’au dénouement. Pour y parvenir, il fallait la subtile et improbable alliance d’ une musique fascinante comme un spectacle de cirque, d’acteurs phénoménaux au sommet de leur art, de dialogues jubilatoires magistralement interprétés, un scénario ciselé, des paysages d’une beauté à couper le souffle, des histoires d’amour (celles qui ont jalonné la vie de Sam Lion, avec les femmes de sa vie, son grand amour décédé très jeune, sa seconde femme, sa fille Victoria pour qui il est un héros et un modèle et qui l’aime inconditionnellement, mais aussi celles d’Albert avec Victoria), jouer avec nos peurs (l’abandon, la disparition des êtres chers, le besoin de reconnaissance), nos fantasmes (disparaître pour un nouveau départ, le dépaysement) et les rêves impossibles (le retour des êtres chers disparus).
Sam Lion va par hasard rencontrer un employé de son entreprise (entre temps il a construit un empire, une entreprise de nettoyage), ce jeune homme maladroit et qui manque de confiance en lui va devenir l’instrument de son retour et sa nouvelle famille. Cela tombe bien : il commence à s’ennuyer.
Peu à peu le puzzle de la vie et des déchirures de Sam Lion, grâce aux flashbacks, se reconstitue, celui des blessures de cet homme qui l’ont conduit à tout quitter, écrasé par les responsabilités sans avoir le temps de penser à ses blessures, ni de les panser, porté par la soif d’ailleurs, de vérité, de liberté.
Alors bien sûr il y a la si célèbre et irrésistible scène du bonjour, toujours incroyablement efficace, tant la candeur d’Albert est parfaitement interprété par Anconina, tant la scène est magistralement écrite, tant les comédiens sont admirablement dirigés mais chaque scène (les acteurs sont filmés en gros plan, au plus près des émotions) sont des moments d’anthologie de comédie, d’humour, de poésie, d’émotion (parfois tout cela en même temps lorsque Victoria est conduite à son père grimé en pompiste et qu’on lui présente comme le sosie parfait de son père qu’elle croit mort, lors de la demande en mariage…) et toujours ces moments qui auraient pu être de simples saynètes contribuent à faire évoluer l’intrigue et à nous faire franchir un cran dans l’émotion, dans ces parfums de vérité qu’affectionne tant le réalisateur. Claude Lelouch ne délaisse aucun de ses personnages ni aucun de ses acteurs. Chacun d’entre eux existe avec ses faiblesses, ses démons, ses failles, ses aspirations. Et puis quelle distribution ! En plus des acteurs principaux : Marie-Sophie L, Michel Beaune, Pierre Vernier, Daniel Gélin.
Jean-Paul Belmondo, plusieurs années après « Un homme qui me plaît » retrouvait ici Claude Lelouch qui lui offre un de ses plus beaux rôles en lui faisant incarner pour la première fois un homme de son âge au visage marqué par le temps mais aussi un personnage non moins héroïque. En choisissant Anconina pour lui faire face, il a créé un des duos les plus beaux et les plus touchants de l’histoire du cinéma.
« Itinéraire d’un enfant gâté » est une magnifique métaphore du cinéma, un jeu constant avec la réalité : cette invention qui nous permet d’accomplir nos rêves et de nous faire croire à l’impossible, y compris le retour des êtres disparus. Belmondo y interprète l’un de ses plus beaux rôles qui lui vaudra d’ailleurs le César du Meilleur Acteur, césar que le comédien refusera d’aller chercher.
On sort de la projection, bouleversés de savoir que tout cela n’était que du cinéma, mais avec la farouche envie de prendre notre destin en main et avec, en tête, la magnifique et inoubliable musique de Francis Lai : « Qui me dira… » et l’idée que si « chaque homme est seul », il possède aussi les clefs pour faire de cette solitude une force, pour empoigner son destin. Et ce dernier plan face à l’horizon nous laisse à la fois bouleversés et déterminés à regarder devant, prendre le large ou en tout cas décider de notre itinéraire. Un grand film intemporel, réjouissant, poignant.
CRITIQUE de LA SIRENE DU MISSISSIPPI de François Truffaut
Après « Baisers volés » (1969) et « La Femme d’à côté » (1981), pour cet hommage à Jean-Paul Belmo,do, je poursuis également le cycle consacré à François Truffaut sur inthemoodforcinema.com, en remontant un peu dans le temps, avec « La Sirène du Mississipi », un film sorti en 1969. Dédié à Jean Renoir, adapté, scénarisé et dialogué par Truffaut d’après un roman de William Irish intitulé « Waltz into Darkness » (pour acquérir les droits François Truffaut dut emprunter à Jeanne Moreau, Claude Lelouch et Claude Berri), c’est davantage vers le cinéma d’Alfred Hitchcock, que lorgne pourtant ce film-ci, lequel Hitchcock s’était d’ailleurs lui-même inspiré d’une nouvelle de William Irish pour « Fenêtre sur cour ». Truffaut avait lui-même aussi déjà adapté William Irish pour « La mariée était en noir », en 1968.
Synopsis : Louis Mahé (Jean-Paul Belmondo) est fabriquant de cigarettes à La Réunion. Il doit épouser Julie Roussel qu’il a rencontrée par petite annonce et dont il doit faire la connaissance le jour du mariage. Lorsqu’elle débarque à La Réunion, d’une beauté aussi froide que ravageuse, elle ressemble peu à la photo qu’il possédait d’elle. Elle lui affirme ainsi lui avoir envoyé un faux portrait, par méfiance. Peu de temps après le mariage, l’énigmatique Julie s’enfuit avec la fortune de Louis. Louis engage alors le solitaire et pointilleux détective Comolli (Michel Bouquet) pour la rechercher, et il rentre en France. Après une cure de sommeil à Nice, il retrouve Julie qui se nomme en réalité Marion (Catherine Deneuve) par hasard, elle travaille désormais comme hôtesse dans une discothèque. Il est déterminé à la tuer mais elle l’apitoie en évoquant son enfance malheureuse et ses sentiments pour lui qui l’aime d’ailleurs toujours… Commence alors une vie clandestine pour ce singulier couple.
Ce film connut un échec public et critique à sa sortie. Truffaut expliqua ainsi cet échec : « Il est aisé d’imaginer ce qui a choqué le monde occidental. La Sirène du Mississipi montre un homme faible (en dépit de son allure), envoûté par une femme forte (en dépit de ses apparences) ». Voir ainsi Belmondo ravagé par la passion qui lui sacrifie tout explique pour Truffaut l’échec du film. C’est vrai que ce film peut dérouter après « Baisers volés », quintessence du style Nouvelle Vague. Son romantisme échevelé, sombre, voire désespéré (même si Doinel était déjà un personnage romantique) mais aussi son mélange des genres (comédie, drame, film d’aventures, film noir, policier) ont également pu dérouter ceux qui voyaient avant tout en Truffaut un des éminents représentants de la Nouvelle Vague.
Comme chacun de ses films « La Sirène du Mississipi » n’en révèle pas moins une maîtrise impressionnante de la réalisation et du sens de la narration, des scènes et des dialogues marquants, des références (cinématographiques mais aussi littéraires) intelligemment distillées et le touchant témoignage d’un triple amour fou : de Louis pour Marion, de Truffaut pour Catherine Deneuve, de Truffaut pour le cinéma d’Hitchcock.
Truffaut traite ainsi de nouveau d’un de ses thèmes de prédilections : l’amour fou, dévastateur, destructeur. Malgré la trahison de la femme qu’il aime, Louis tue pour elle et la suit au péril de sa propre existence… Après les premières scènes, véritable ode à l’île de La Réunion qui nous laisse penser que Truffaut va signer là son premier film d’aventures, exotique, le film se recentre sur leur couple, la troublante et trouble Marion, et l’amour aveugle qu’elle inspire à Louis. Truffaut traitera ce thème de manière plus tragique, plus subtile, plus précise encore dans « L’Histoire d’Adèle.H », dans « La Peau douce » (réalisé avant « La Sirène du Mississipi) notamment ou, comme nous l’avons vu, dans « La Femme d’à côté », où, là aussi, Bernard (Gérard Depardieu) emporté par la passion perd ses repères sociaux, professionnels, aime à en perdre la raison avec un mélange détonant de douceur et de douleur, de sensualité et de violence, de joie et de souffrance dont « La sirène du Mississipi » porte déjà les prémisses.
Bien qu’imprégné du style inimitable de Truffaut, ce film est donc aussi une déclaration d’amour au cinéma d’Hitchcock, leurs entretiens restant le livre de référence sur le cinéma hitchcockien (si vous ne l’avez pas encore, je vous le conseille vivement, il se lit et relit indéfiniment, et c’est sans doute une des meilleures leçons de cinéma qui soit). « Les Oiseaux », « Pas de printemps pour Marnie », « Sueurs froides», « Psychose », autant de films du maître du suspense auxquels se réfère « La Sirène du Mississipi ». Et puis évidemment le personnage même de Marion interprétée par Catherine Deneuve, femme fatale ambivalente, d’une beauté troublante et mystérieuse, d’une blondeur et d’une froideur implacables, tantôt cruelle, tantôt fragile, empreinte beaucoup aux héroïnes hitchcockiennes, à la fois à Tippie Hedren dans « Pas de printemps pour Marnie » ou à Kim Novak dans « Sueurs froides » notamment pour la double identité du personnage dont les deux prénoms (Marion et Julie) commencent d’ailleurs comme ceux de Kim Novak dans le film d’Hitchcock- Madeleine et Judy-.
A Deneuve, qui vient d’accepter le film, Truffaut écrivit : « Avec La Sirène, je compte bien montrer un nouveau tandem prestigieux et fort : Jean-Paul, aussi vivant et fragile qu’un héros stendhalien, et vous, la sirène blonde dont le chant aurait inspiré Giraudoux. » Et il est vrai qu’émane de ce couple, une beauté ambivalente et tragique, un charme tantôt léger tantôt empreint de gravité. On retrouve Catherine Deneuve et Jean-Paul Belmondo dans des contre-emplois dans lesquels ils ne sont pas moins remarquables. Elle en femme fatale, vénale, manipulatrice, sirène envoûtante mais néanmoins touchante dont on ne sait jamais vraiment si elle aime ou agit par intérêt. Lui en homme réservé, follement amoureux, prêt à tout par amour, même à tuer.
A l’image de l’Antiquaire qui avait prévenu Raphaël de Valentin dans « La Peau de chagrin » à laquelle Truffaut se réfère d’ailleurs, Louis tombant par hasard sur le roman en question dans une cabane où ils se réfugient ( faisant donc de nouveau référence à Balzac après cette scène mémorable se référant au « Lys dans la vallée » dans « Baisers volés »), et alors que la fortune se réduit comme une peau de chagrin, Marion aurait pu dire à Louis : « Si tu me possèdes, tu possèderas tout, mais ta vie m’appartiendra ».
Enfin ce film est une déclaration d’amour de Louis à Marion mais aussi et surtout, à travers eux, de Truffaut à Catherine Deneuve comme dans cette scène au coin du feu où Louis décrit son visage comme un paysage, où l’acteur semble alors être le porte-parole du cinéaste. Le personnage insaisissable, mystérieux de Catherine Deneuve contribue largement à l’intérêt du film, si bien qu’on imagine difficilement quelqu’un d’autre interprétant son rôle.
Comme souvent, Truffaut manie l’ellipse avec brio, joue de nouveau avec les temporalités pour imposer un rythme soutenu. Il cultive de nouveau le hasard comme dans « Baisers volés » où il était le principal allié de Doinel, pour accélérer l’intrigue.
Alors, même si ce film n’est pas cité comme l’un des meilleurs de Truffaut, il n’en demeure pas moins fiévreux, rythmé, marqué par cette passion, joliment douloureuse, qui fait l’éloge des grands silences et que symbolise si bien le magnifique couple incarné par Deneuve et Belmondo. Avec « La Sirène du Mississipi » qui passe brillamment de la légèreté au drame et qui dissèque cet amour qui fait mal, à la fois joie et souffrance, Truffaut signe le film d’un cinéaste et d’un cinéphile comme récemment Pedro Almodovar avec « Les Etreintes brisées ».
« La Sirène du Mississipi » s’achève par un plan dans la neige immaculée qui laisse ce couple troublant partir vers son destin, un nouveau départ, et nous avec le souvenir ému de cet amour fou dont Truffaut est sans doute le meilleur cinéaste.
Dix ans plus tard, Catherine Deneuve interprétera de nouveau une Marion dans un film de Truffaut « Le dernier métro », et sera de nouveau la destinataire d’ une des plus célèbres et des plus belles répliques de Truffaut, et du cinéma, que Belmondo lui adresse déjà dans « La Sirène du Mississipi »:
« – Quand je te regarde, c’est une souffrance.
– Pourtant hier, tu disais que c’était une joie.
– C’est une joie et une souffrance. »
Sans doute une des meilleures définitions de l’amour, en tout cas de l’amour dans le cinéma de Truffaut… que nous continuerons à analyser prochainement avec « L’Histoire d’Adèle.H ». En attendant je vous laisse méditer sur cette citation et sur le chant ensorcelant et parfois déroutant de cette insaisissable « Sirène du Mississipi ».
CRITIQUE de BORSALINO de Jacques Deray
Basé sur le roman « Bandits à Marseille » d’Eugène Saccomano, « Borsalino » est inspiré de l’histoire des bandits Carbone et Spirito dont les noms avaient finalement été remplacés en raison de leurs rôles pendant l’Occupation. On y retrouve, outre Delon et Belmondo, Nicole Calfan, Françoise Christophe, Corinne Marchand, Mireille Darc (qui fait une apparition remarquée) mais aussi Michel Bouquet, Julien Guiomar, Mario David, Laura Adani. Les dialogues sont signés Jean-Claude Carrière, co-scénariste avec Claude Sautet, Jacques Deray, Jean Cau. Rien de moins !
Début des années 30 à Marseille. Roch Siffredi (Alain Delon) sort de prison. Venu retrouver son amie Lola (Catherine Rouvel) il rencontre par la même occasion son nouvel amant François Capella (Jean-Paul Belmondo). S’ensuit une bagarre entre les deux rivaux, elle scellera le début d’une indéfectible amitié. Capella cherche à se faire une place dans la pègre marseillaise. Les deux truands vont ainsi se trouver et se respecter. De cette réunion va naître une association de malfaiteurs florissante puis une amitié à la vie, à la mort qui va leur permettre de gravir les échelons de la Pègre marseillaise !
D’un côté, Capella/Belmondo séducteur, désinvolte, bon vivant, aux goûts clinquants et aux manières cavalières. De l’autre Siffredi/Belmondo élégant, ambitieux, taciturne, froid, implacable, presque inquiétant. Deux mythes du cinéma face à face, côte à côte qui jouent avec leurs images. Parfois avec dérision (ah la scène de la baignade, ah la bagarre…), démontrant ainsi d’ailleurs l’humour dont ils savaient et savent faire preuve même celui dont ses détracteurs l’accusaient à tort d’en être dépourvu, même si dans le DVD on reconnaît plus volontiers cette qualité à Jean-Paul Belmondo et à Delon… sa générosité. Jouant avec leur image encore lorsqu’ils deviennent des gangsters stars sur le passage desquels on se détourne, et applaudis par la foule, comme ils le sont en tant qu’acteurs.
C’est aussi un hommage aux films de gangsters américains, aux films de genre, avec leurs voitures rutilantes, leurs tenues élégantes parfois aussi clinquantes (dont le fameux Borsalino qui inspira le titre du film), leurs femmes fatales mystérieuses ou provocantes, leurs lieux aussi folkloriques et hauts en couleurs que les personnages qui les occupent. En toile de fond la pittoresque Marseille, Marseille des années 30, sorte de Chicago française, Marseille luxueusement reconstituée que Deray filme avec minutie, chaleur, avec l’allégresse qui illumine son film influencé par l’atmosphère ensoleillée et chaleureuse de Marseille. Sa caméra est alerte et virevoltante et elle accompagne avec une belle légèreté et application quelques scènes d’anthologie comme celle de la fusillade dans la boucherie. Tout cela donne au film une vraie « gueule d’atmosphère » qui n’appartient qu’à lui. Et s’il n’y a pas réellement de suspense, Deray nous fait suivre et vivre l’action sans penser à la suivante, à l’image de Siffredi et Capella qui vivent au jour le jour; il ne nous embarque pas moins avec vivacité dans cette ballade réjouissante, autant teintée d’humour et de second degré (dans de nombreuses scènes mais aussi dans les dialogues, savoureux) que de nostalgie, voire de mélancolie suscitée par la solitude du personnage de Delon dont la majesté de fauve, parfois la violence, semblent être les masques de la fragilité. Et dont la solitude fait écho à celle de l’acteur, auréolé d’un séduisant mystère. Celui d’un fauve blessé.
Un film que ses deux acteurs principaux font entrer dans la mythologie de l’Histoire du cinéma, et qui joue intelligemment avec cette mythologie, ce film étant par ailleurs avant tout un hymne à l’amitié incarnée par deux prétendus rivaux de cinéma. Ce sont évidemment deux rôles sur mesure pour eux mais c’est aussi toute une galerie de portraits et de personnages aussi pittoresques que la ville dans laquelle ils évoluent qui constitue d’ailleurs un véritable personnage (parmi lesquels le personnage de l’avocat magistralement interprété par Michel Bouquet). Un film avec un cadre, une ambiance, un ton, un décor, deux acteurs uniques. Et puis il y a l’inoubliable musique de Claude Bolling avec ses notes métalliques parfois teintées d’humour et de violence, de second degré et de nostalgie, d’allégresse et de mélancolie, de comédie et de polar entre lesquels alterne ce film inclassable.
« Borsalino » fut nommé aux Golden Globes et à l’ours d’or. Quatre ans plus tard Jacques Deray réalisera Borsalino and co, de nouveau avec Alain Delon, sans connaître le même succès auprès du public et de la critique. Reste un film qui, 40 ans après, n’a rien perdu de son aspect jubilatoire et semble même aujourd’hui encore, pour son habile mélange des genres, en avoir inspiré beaucoup d’autres. Imité, rarement égalé. En tout cas inimitable pour ses deux personnages principaux que ses deux acteurs mythiques ont rendu à leur tour mythiques, les faisant entrer dans la légende, et dans nos souvenirs inoubliables, inégalables et attendris de cinéphiles.
Articles liés à celui-ci:

L’actualité des festivals de cinéma sur Inthemoodforcinema.com
novembre 01, 2022
Compte rendu du 44ème Festival du Cinéma Américain de Deauville
septembre 25, 2018
En direct du 71ème Festival de Cannes
mai 05, 2018
César 2018 : annonce des nominations ce 31 janvier 2018 à 10H
janvier 30, 2018
Mobile film festival : appel à films jusqu’au 9 janvier 2018
janvier 03, 2018
CESAR 2017 : les nominations complètes
janvier 25, 2017
Globes de Cristal 2017 présidés par Catherine Deneuve : liste des nommés
décembre 16, 2016
Programme du Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz 2016
septembre 18, 2016











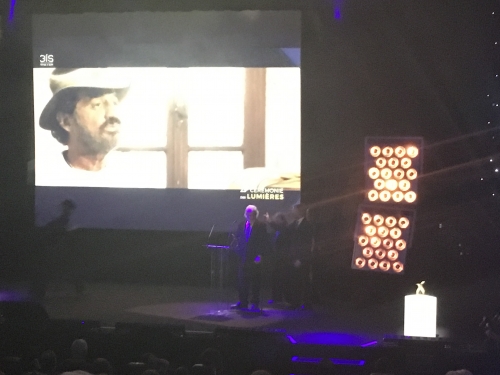




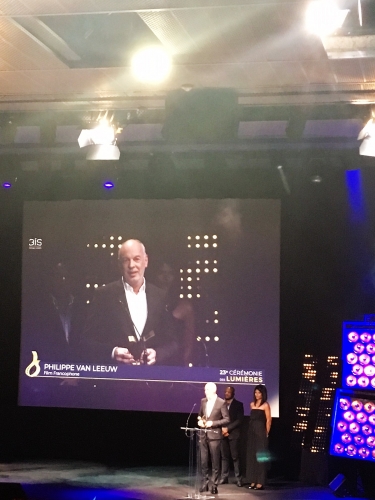






































Natalie sent you a private message! View Message: https://sklbx.com/ny3g0ufO?xxy [hs=2088cb67558369afff30f816e6ed9875]
1bi3q7
All the girls from next door are here with their cams! Visit Cam: https://letsg0dancing.page.link/go?hs=2088cb67558369afff30f816e6ed9875&
tqiocl
Get free iPhone 15: https://linkmanagements.com/uploads/go.php hs=2088cb67558369afff30f816e6ed9875*
p0g9af
You got 30 737 Dollars. Gо tо withdrаwаl >> https://forms.yandex.com/cloud/65cc7b36c769f12aee2e880d/?hs=2088cb67558369afff30f816e6ed9875&
xe2r1l
Withdrawing 44 354 Dollars. Gо tо withdrаwаl >>> https://forms.yandex.com/cloud/65c3b4de3e9d08158a59a30a/?hs=2088cb67558369afff30f816e6ed9875&
m1xao7
You got 50 153 Dollars. Gо tо withdrаwаl => https://forms.yandex.com/cloud/65cb92cf02848f13c7cbf7f6/?hs=2088cb67558369afff30f816e6ed9875&
6uq396
Withdrawing 39 354 Dollars. GЕТ =>> https://forms.yandex.com/cloud/65db1184c09c022dc9cfbaa8?hs=2088cb67558369afff30f816e6ed9875&
8jif8u
Transaction 33 799 $. GЕТ => https://telegra.ph/BTC-Transaction--803100-03-14?hs=2088cb67558369afff30f816e6ed9875&
amyp6w